EUGÉNIE
Voyons, voyons, monsieur, comment votre philosophie explique cette sorte de délit. Il est affreux, n’est-ce pas ?
DOLMANCÉ
Commencez à partir d’un point, Eugénie, c’est que rien n’est affreux en libertinage, parce que tout ce que le libertinage inspire l’est également par la nature ; les actions les plus extraordinaires, les plus bizarres, celles qui paraissent choquer le plus évidemment toutes les lois, toutes les institutions humaines (car pour le ciel, je n’en parle pas), eh bien, Eugénie, celles-là même ne sont point affreuses, et il n’en est pas une d’elles qui ne puisse se démontrer dans la nature ; il est certain que celle dont vous me parlez, belle Eugénie, est la même relativement à laquelle on trouve une fable si singulière dans le plat roman de l’Écriture Sainte, fastidieuse compilation d’un juif ignorant, pendant la captivité de Babylone ; mais il est faux, hors de toute vraisemblance, que ce soit en punition de ces écarts que ces villes ou plutôt ces bourgades aient péri par le feu ; placées sur le cratère de quelques anciens volcans, Sodome, Gomorrhe périrent comme ces villes de l’Italie qu’engloutirent les laves du Vésuve ; voilà tout le miracle, et ce fut pourtant de cet événement tout simple que l’on partit pour inventer barbarement le supplice du feu contre les malheureux humains qui se livraient dans une partie de l’Europe à cette naturelle fantaisie.
EUGÉNIE
Oh ! naturelle !
DOLMANCÉ
Oui, naturelle, je le soutiens ; la nature n’a pas deux voix, dont l’une fasse journellement le métier de condamner ce que l’autre inspire, et il est bien certain que ce n’est que par son organe que les hommes entichés de cette manie reçoivent les impressions qui les y portent. Ceux qui veulent proscrire ou condamner ce goût prétendent qu’il nuit à la population. Qu’ils sont plats ces imbéciles qui n’ont jamais que cette idée de population dans la tête et qui ne voient, jamais que du crime à tout ce qui s’éloigne de là ! Est-il donc démontré que la nature ait de cette population un aussi grand besoin qu’ils voudraient nous le faire croire ? Est-il bien certain qu’on l’outrage chaque fois qu’on s’écarte de cette stupide propagation ? Scrutons un instant, pour nous en convaincre, et sa marche et ses lois. Si la nature ne faisait que créer et qu’elle ne détruisît jamais, je pourrais croire avec ces fastidieux sophistes que le plus sublime de tous les actes serait de travailler sans cesse à celui qui produit, et je leur accorderais à la suite de cela que le refus de produire devrait nécessairement être un crime ; le plus léger coup d’œil sur les opérations de la nature ne prouve-t-il pas que les créations, que l’une et l’autre de ces opérations se lient et s’enchaînent même si intimement qu’il devient impossible que l’une puisse agir sans l’autre ? que rien ne naîtrait, rien ne se régénérerait sans des destructions ? La destruction est donc une des lois de la nature comme la création. Ce principe admis, comment puis-je offenser cette nature, en refusant de créer ? ce qui, à supposer un mal à cette action, en deviendrait un infiniment moins grand, sans doute, que celui de détruire, qui pourtant se trouve dans ses lois, ainsi que je viens de le prouver. Si, d’un côté, j’admets donc le penchant que la nature me donne à cette perte, que j’examine, de l’autre, qu’il lui est nécessaire et que je ne fais qu’entrer dans ses vues en m’y livrant, où sera le crime, alors, je vous le demande ? Mais vous objectent encore les sots et les populateurs, ce qui est synonyme, ce sperme productif ne peut être placé dans vos reins à aucun autre usage que pour celui de la propagation ; l’en détourner est une offense. Je viens d’abord de prouver que non, puisque cette perte n’équivaudrait même pas à une destruction bien plus importante que la perte, ne serait pas elle-même un crime. Secondement, il est faux que la nature veuille que cette liqueur spermatique soit absolument et entièrement destinée à produire ; si cela était, non seulement elle ne permettrait pas que cet écoulement eùt lieu dans tout autre cas, comme nous le prouve l’expérience, puisque nous la perdons quand nous voulons et où nous voulons, et ensuite elle s’opposerait à ce que ces pertes eussent lieu sans coït, comme il arrive, et dans nos souvenirs ; avare d’une liqueur aussi précieuse, ce ne serait jamais que dans le vase de la propagation qu’elle en permettrait l’écoulement ; elle ne voudrait assurément pas que cette volupté, dont elle nous couronne alors, pût être ressentie quand nous détournerions l’hommage ; car il ne serait pas raisonnable de supposer qu’elle consentit à nous donner du plaisir, même au moment où nous l’accablerions d’outrages. Allons plus loin : si les femmes n’étaient nées que pour produire, ce qui serait assurément si cette production était si chère à la nature, arriverait-il que sur la plus longue vie d’une femme il ne se trouve cependant que sept ans, toute déduction faite, où elle soit en état de donner la vie à son semblable ? Quoi ! la nature est avide de propagations ; tout ce qui ne tend pas à ce but l’offense, et sur cent ans de vie, le sexe destiné à produire ne le pourra que pendant sept ans ! La nature ne veut que des propagations, et la semence qu’elle prête à l’homme pour servir ces propagations, se perd tant qu’il plaît à l’homme ! Il trouve le même plaisir à cette perte qu’à l’emploi utile, et jamais le moindre inconvénient !…
Cessons, mes amis, cessons de croire à de telles absurdités ; elles font frémir le bon sens. Ah ! loin d’outrager la nature, persuadons-nous bien, au contraire, que le sodomite et la tribade la servent, en se refusant opiniâtrement à une conjonction dont il ne résulte qu’une progéniture fastidieuse pour elle. Cette propagation, ne nous trompons point, ne fut jamais une de ses lois, mais une tolérance tout au plus, je vous l’ai dit. Eh ! que lui importe que la race des hommes s’éteigne ou s’anéantisse sur la terre ! Elle rit de notre orgueil à nous persuader que tout finirait si ce malheur avait lieu ! Mais elle ne s’en apercevrait seulement pas.
S’imagine-t-on qu’il n’y ait pas déjà des races éteintes ? Buffon en compte plusieurs, et la nature, muette à une perte aussi précieuse, ne s’en aperçoit seulement pas. L’espèce entière s’anéantirait que l’air n’en serait ni moins pur, l’astre ni moins brillant, la marche de l’univers moins exacte.
Qu’il fallait d’imbécillité cependant pour croire que notre espèce est tellement utile au monde que celui qui ne travaillerait pas à la propager, ou qui troublerait cette propagation deviendrait nécessairement un criminel ! Cessons de nous aveugler à ce point, et que l’exemple des peuples, plus raisonnables que nous, serve à nous persuader de nos erreurs. Il n’y a pas un seul coin sur la terre où ce prétendu crime de sodomie n’ait eu des temples et des sectateurs. Les Grecs, qui en faisaient pour ainsi dire une vertu, lui érigèrent une statue sous le nom de Vénus Callipyge ; Rome envoya chercher des lois à Athènes, et elle en rapporta ce goût divin. Quel progrès ne lui voyons-nous pas faire sous les empereurs ? À l’abri des aigles romaines, il s’étend d’un bout de la terre à l’autre ; à la destruction de l’empire, il se réfugie près de la tiare, il suit les arts en Italie, il nous parvient quand nous nous poliçons. Découvrons-nous un hémisphère, nous y trouvons la sodomie. Cook mouille dans un nouveau monde : elle y règne. Si nos ballons eussent été dans la lune, elle s’y serait trouvée de même. Goût délicieux ! enfant de la nature et du plaisir, vous devez être partout où se trouveront les hommes ; et partout où l’on vous aura connu, l’on vous érigera des autels !… Eh bien, petit ange, es-tu convertie ? cesses-tu de croire que la sodomie soit un crime ?
EUGÉNIE
Et quand elle en serait un, que m’importe ? Ne m’avez-vous pas démontré le néant des crimes ? Il est bien peu d’actions maintenant qui soient criminelles à mes yeux.
DOLMANCÉ
Il n’est de crime à rien, chère fille, à quoi que ce soit au monde ; la plus monstrueuse des actions n’a-t-elle pas un côté par lequel elle nous est propice ?
EUGÉNIE
Qui en doute ?
DOLMANCÉ
Eh bien ! de ce moment elle cesse d’être un crime ; car pour que ce qui sert l’un en nuisant à l’autre fût un crime, il faudrait démontrer que l’être lésé est plus précieux à la nature que l’être servi ; or, tous les individus étant égaux aux yeux de la nature, cette prédilection est impossible ; donc l’action qui sert l’un en nuisant à l’autre est d’une indifférence parfaite à la nature.
Mais si l’action nuisait à une très grande quantité d’individus et qu’elle ne nous rapportât à nous qu’une très légère dose de plaisir, ne serait-il pas affreux de s’y livrer alors ?
DOLMANCÉ
Pas davantage, parce qu’il n’y a aucune comparaison entre ce qu’éprouvent les autres et ce que nous ressentons ; la plus forte dose de douleur chez les autres doit assurément être nulle pour nous, et le plus léger chatouillement de plaisir éprouvé par nous nous touche ; donc nous devons, à quel prix que ce soit, préférer ce léger chatouillement qui nous délecte à cette somme immense de malheurs d’autrui, qui ne saurait nous atteindre ; mais s’il arrive, au contraire, que la singularité de nos organes, une construction bizarre nous rendent agréables les douleurs du prochain, ainsi que cela arrive souvent, qui doute alors que nous ne devions incontestablement préférer cette douleur d’autrui qui nous amuse à l’absence de cette douleur qui deviendrait une privation pour nous ? La source de toutes nos erreurs en morale vient de l’admission ridicule de ce fil de fraternité qu’inventèrent les chrétiens dans leur siècle d’infortune et de détresse. Contraints à mendier la pitié des autres, il n’était pas maladroit d’établir qu’ils étaient tous frères. Comment refuser des secours d’après une telle hypothèse ? Mais il est impossible d’admettre cette doctrine. Ne naissons-nous pas tous isolés ? je dis plus, tous ennemis les uns des autres ? tous dans un état de guerre perpétuelle et réciproque ? Or je vous demande si cela serait, dans la supposition que les vertus, exigées par ce prétendu fil de fraternité, fussent réellement dans la nature ? Si sa voix les inspirait aux hommes, ils les éprouveraient en naissant. Dès lors la pitié, la bienfaisance, l’humanité seraient des vertus naturelles, dont il serait impossible de se défendre et qui rendraient cet état primitif de l’homme sauvage totalement contraire à ce que nous le voyons.
Mais si, comme vous le dites, la nature fait naître les hommes isolés, tous indépendamment les uns des autres, au moins m’accorderez-vous que les besoins, en les rapprochant, ont dû nécessairement établir quelques liens entre eux ; de là, ceux du sang nés de leur alliance réciproque, ceux de l’amour, de l’amitié, de la reconnaissance ; vous respecterez au moins ceux-là, j’espère ?
DOLMANCÉ
Pas plus que les autres, en vérité ; mais analysons-les, je le veux : un coup d’oeil rapide, Eugénie, sur chacun en particulier.
Direz-vous, par exemple, que le besoin de me marier, ou pour voir prolonger ma race, ou pour arranger ma fortune, doit établir des liens indissolubles ou sacrés avec l’objet auquel je m’allie ? Ne serait-ce pas, je vous le demande, une absurdité que de soutenir cela ? Tant que dure l’acte du coït, je peux, sans doute, avoir besoin de cet objet pour y participer ; mais sitôt qu’il est satisfait, que reste-t-il, je vous prie, entre lui et moi ? et quelle obligation réelle enchaînera à lui ou à moi les résultats de ce coït ? Ces derniers liens furent les fruits de la frayeur qu’eurent les parents d’être abandonnés dans leur vieillesse, et les soins intéressés qu’ils ont de nous dans notre enfance ne sont que pour mériter ensuite les mêmes attentions dans leur dernier âge.
Cessons d’être la dupe de tout cela ; nous ne devons rien à nos parents… pas la moindre chose, Eugénie, et comme c’est bien moins pour nous que pour eux qu’ils ont travaillé, il nous est permis de les détester et de nous en défaire, même si leur procédé nous irrite ; nous ne devons les aimer que s’ils agissent bien avec nous, et cette tendresse alors ne doit pas avoir un degré de plus que celle que nous aurions pour d’autres amis, parce que les droits de la naissance n’établissent rien, ne fondent rien, et qu’en les scrutant avec sagesse et réflexion, nous n’y trouverions sûrement que des raisons de haine pour ceux qui, ne songeant qu’à leurs désirs, ne nous ont donné souvent qu’une existence malheureuse ou malsaine.
Vous me parliez des liens de l’amour, Eugénie ; puissiez-vous jamais ne les connaître ! Ah ! qu’un tel sentiment, pour le bonheur que je vous souhaite, n’approche jamais de votre coeur ! Qu’est-ce que l’amour ? On ne peut le considérer, ce me semble, que comme l’effet résultatif des qualités d’un bel objet sur nous ; ces effets nous transportent, ils nous enflamment ; si nous possédons cet objet, nous voilà contents ; s’il nous est impossible de l’avoir, nous nous désespérons. Mais quelle est la base de ce sentiment ? le désir. Quelles sont les suites de ce sentiment ? la folie. Tenons-nous-en donc au motif et garantissons-nous des effets. Le motif est de posséder l’objet ; eh bien ! tâchons de réussir, mais avec sagesse ; jouissons-en dès que nous l’avons ; consolons-nous dans le cas contraire ; mille autres objets semblables, et souvent bien meilleurs, nous consoleront de la perte de celui-là ; tous les hommes, toutes les femmes se ressemblent ; il n’y a point d’amour qui résiste aux effets d’une réflexion saine. Oh ! quelle duperie que cette ivresse qui, absorbant en nous le résultat des sens, nous met dans un tel état que nous ne voyons plus, que nous n’existons plus que par cet objet follement adoré ! Est-ce donc là vivre ? N’est-ce pas bien plutôt se priver volontairement de toutes les douceurs de la vie ? N’est-ce pas vouloir rester dans une fièvre brûlante qui nous absorbe et qui nous dévore sans nous laisser d’autre bonheur que des jouissances métaphysiques si ressemblantes aux effets de la folie ? Si nous devions toujours l’aimer, cet objet adorable, s’il était certain que nous ne dussions jamais l’abandonner, ce serait encore une extravagance sans doute, mais excusable au moins. Cela arrive-t-il ? A-t-on beaucoup d’exemples de ces liaisons éternelles qui ne se sont jamais démenties ? Quelques mois de jouissances, remettant l’objet à sa véritable place, nous font rougir de l’encens que nous avons brille sur ses autels, et nous arrivons souvent à ne pas même concevoir qu’il ait pu nous séduire à ce point.
Ô ! filles voluptueuses, livrez-nous donc vos corps tant que vous le pourrez !… Divertissez-vous, voilà l’essentiel ; mais fuyez avec soin l’amour. Il n’y a de bon que son physique, disait le naturaliste Buffon, et ce n’était pas sur cela seul qu’il raisonnait en bon philosophe. Je le répète, amusez-vous, mais n’aimez point. Les femmes ne sont pas faites pour un seul homme, c’est pour tous que les a créées la nature. N’écoutant que cette voix sacrée, qu’elles se livrent indifféremment à tous ceux qui veulent d’elles. Toujours putains, jamais amantes, fuyant l’amour, adorant le plaisir, ce ne seront plus que des roses qu’elles trouveront dans la carrière de la vie ; ce ne seront plus que des fleurs qu’elles nous prodigueront !…
La dernière partie de mon analyse porte donc sur les liens de l’amitié et sur ceux de la reconnaissance. Respectons les premiers, j’y consens, tant qu’ils nous sont utiles ; gardons nos amis tant qu’ils nous servent ; oublions-les dès que nous n’en tirons plus rien ; ce n’est jamais que pour soi qu’il faut aimer les gens ; les aimer pour eux-mêmes n’est qu’une duperie ; jamais il n’est dans la nature d’inspirer aux hommes d’autres mouvements, d’autres sentiments que ceux qui doivent leur être bons à quelque chose ; rien n’est égoïste comme la nature : soyons-le donc aussi si nous voulons accomplir ses lois.
Quant à la reconnaissance, Eugénie, c’est le plus faible de tous les liens sans doute. Est-ce donc pour nous que les hommes nous obligent ? N’en croyons rien, ma chère ; c’est par ostentation, par orgueil. N’est-il donc pas humiliant, dès lors, de devenir ainsi le jouet de l’amour-propre des autres ? ne l’est-il pas encore davantage d’être obligé ? Rien de plus à charge qu’un bienfait reçu. Point de milieu il faut le rendre ou en être avili. Les âmes fières se font mal au poids du bienfait : il pèse sur elles avec tant de violence que le seul sentiment qu’elles exhalent est de la haine pour le bienfaiteur.
Quels sont donc maintenant, à votre avis, les liens qui suppléent à l’isolement où nous a créés la nature ? Quels sont ceux qui doivent établir des rapports entre les hommes ?
À quels titres les aimerons-nous, les chérirons-nous, les préférerons-nous à nous-mêmes ? De quel droit soulagerons-nous leur infortune ? Où sera maintenant dans nos âmes le berceau de belles et inutiles vertus de bienfaisance, d’humanité, de charité, indiquées dans le code absurde de quelques religions imbéciles qui, prêchées par des imposteurs ou par des mendiants, durent nécessairement conseiller ce qui pouvait les soutenir ou les tolérer ?
Eh bien ! Eugénie, admettez-vous encore quelque chose de sacré parmi les hommes ? Concevez-vous quelques raisons de ne pas toujours nous préférer à eux ?
EUGÉNIE
Ces leçons, que mon coeur devance, me flattent trop pour que mon esprit les récuse.
DOLMANCÉ
Elles sont dans la nature, Eugénie ; la seule approbation que tu leur donnes le prouve ; à peine éclose de son sein, comment ce que tu sens pourrait-il être le fruit de la corruption ?
EUGÉNIE
Mais si toutes les erreurs que vous préconisez sont dans la nature, pourquoi les lois s’y opposent-elles ?
DOLMANCÉ
Parce que les lois ne sont pas faites pour le particulier, mais pour le général, ce qui les met dans une perpétuelle contradiction avec l’intérêt personnel, attendu que l’intérêt personnel l’est toujours avec l’intérêt général. Mais les lois, bonnes pour la société, sont très mauvaises pour l’individu qui la compose ; car, pour une fois qu’elles le protègent ou le garantissent, elles le gênent et le captivent les trois quarts de sa vie ; aussi l’homme sage et plein de mépris pour elles les tolère-t-il comme il fait des serpents et des vipères qui, bien qu’elles blessent ou qu’elles empoisonnent, servent pourtant quelquefois dans la médecine ; il se garantira des lois comme il le fera de ces bêtes venimeuses ; il s’en mettra à l’abri par des précautions, par des mystères, toutes choses faciles à la sagesse et à la prudence.
Donatien Alphonse François de Sade
![]()
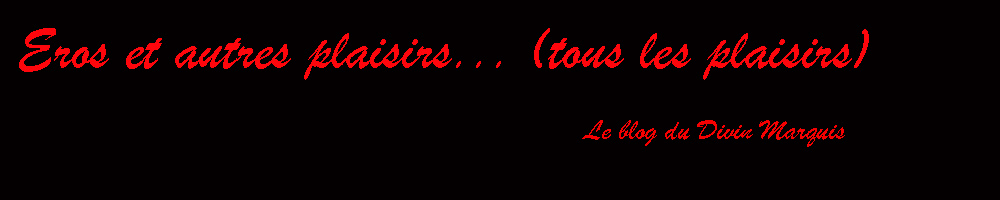












Commentaires